» Salon du livre Paris
» Table ronde Unesco
» Rencontres SHS
» Le Nouveau recueil
» Éloge de la revue
» Retombées 17e Salon
» Revues & Bibliothèques
» Revues en librairies
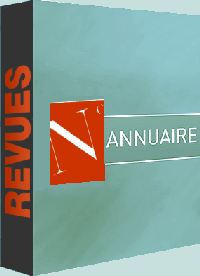 Il recense les coordonnées
Il recense les coordonnées
de
2422 revues culturelles francophones.
 Notre revue consacrée
Notre revue consacrée
à l'histoire et
à l'actualité
des revues.
Les actualités d'Ent'revue
Archives 2008
« Revues et bibliothèques, quels partenariats ? »
Groupe interprofessionnel de réflexion
Compte rendu de la séance du 22 mai 2007, Paris
 en présence de :
en présence de :
- Philippe Babo (CNL, Bureau ouvrages spécialisés, revues et multimédias)
- Louis Burle (Bibliothèque de Troyes)
- André Chabin (Ent'revues)
- Catherine Chauchard (Bilipo)
- Valérie Degrelle (Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou)
- Agnès Foucher (Bibliothèque des Ulis)
- Pierre Gandil (Bibiothèque de Metz)
- Christiane Fortassin (association Bibliothèques en Seine Saint-Denis)
- Jean Guiloineau (revue Siècle 21)
- Jean-Michel Henny (MSH)
- Caroline Hoctan (historienne des revues)
- Christine Langlois (revue Terrain)
- Alain Massuard (IMEC)
- Pierre Maubé (bibliothèque inter-universitaire Sainte-Barbe)
- Raphaël Meltz (revue Le Tigre)
- Hélène Morice (bibliothèque de Fresnes)
- Amaury Noroy (revue Tra-jectoires)
- Jean-Baptiste Para (revue Europe)
- Xavier Person (Région Île-de-France, mission Livre et lecture)
- Isabelle Reverdy (Région Île-de-France, mission Livre et lecture)
- José Ruiz-Funes (IMEC)
- Renée Zuza (CNL, numérisation et création de revues électroniques)
En préalable :
- la notion même de revue ne va pas de soi dans le domaine bibliothéconomique, elle sera incluse dans la rubrique « périodiques », comme on le lira ci-dessous.
- la diversité et l'inventivité des revues peut parfois déconcerter, bibliothécaires ou libraires, et desservir leurs buts : grandes différences de formats, présentation, de périodicité, de contenu.
- le temps des revues est un temps intermédiaire entre celui du livre et du magazine/de la presse : lectures discontinues, déconnectée de (mais pas forcément sans rapport avec) l'actualité, leur exigence demande aussi un temps de découverte, d'approche et d'appropriation.
1. pourquoi si peu de revues dans les bibliothèques ?
- contraintes du système budgétaire : il s'agit d'un poste « périodiques » comprenant la presse, les magazines mais aussi les dictionnaires, annuaires et des publications annuelles (le Quid, par exemple);
- pression de la demande du public pour la presse et les magazines généralistes ou de loisirs, qui laisse peu de place aux revues ;
- contraintes du système de « rentabilité », de lecture effective : les titres retenus doivent être « suffisamment » empruntés pour être considérés comme rentables, ce qui est rarement le cas pour les revues ; les bibliothèques sont alors souvent obligées de renoncer à des abonnements ;
- le choix des périodiques repose sur ce que la profession considère comme étant l'attente du public. Il y a peu de propositions alternatives, alors que les bibliothèques devraient être aussi un lieu de découverte, quand la presse et les livres sont présents, sinon disponibles, dans le paysage quotidien (kiosques, maisons de la presse, librairies mais aussi et de plus en plus les grandes surfaces), médiatique (comptes rendus, chroniques radiodiffusées, télévisées, dans la presse, dont on peut déplorer la diminution, l'appauvrissement et le manque de reconnaissance pour les revues – du reste, celles-ci effectuent de moins en moins ces exercices de critique et d'échange, de faire-savoir) et publicitaire ;
- contraintes de localisation : si la plupart des revues se posent la question de la lisibilité, beaucoup d'entre elles veulent être autre chose : revues-affiches ou porte-folio, format journal ou opuscules, livre-objet ou « presqu'encore-fanzine ». Leur simple mise à disposition peut, comme en librairie, poser problème. Leur périodicité est également parfois problématique : un abonnement à une jeune revue est un pari, le rythme de publication s'efforce de rester régulier. Quel traitement appliquer à une revue annuelle, est-ce le même que pour une mensuelle, et quid des erratiques assumées ? Enfin, leurs contenus même réservent des surprises : les revues thématiques peuvent rejoindre les rayonnages de livres, au risque de s'y perdre (création littéraire, sciences humaines) mais beaucoup ont choisi des voies de traverse, pluridisciplinaires, mêlant les points de vue, changeant même d'un numéro l'autre : comment alors les présenter ?
2. Formation - moyens
- la formation de bibliothécaire est plutôt axée sur les techniques bibliothéconomiques. Les contenus sont très peu abordés, de la "culture générale" à une culture littéraire ou scientifique : le champ particulier des revues est noyé dans la masse des périodiques, magazines et presse.
- la présence de revues découle alors de l'initiative personnelle d'un bibliothécaire, apportant son savoir et sa sensibilité propres : un changement d'affectation peut décider de l'arrêt d'actions envers les revues.
- la tentative d'élargir le lectorat par l'indexation des revues (leur permettant d'être interrogeables et accessibles par une recherche thématique dans le catalogue) n'est satisfaisante que pour les revues thématiques, pas pour les revues pluridisciplinaires : on retrouve ici les contraintes de localisation "physique" évoquées plus haut. A qui s'adresse cette indexation, aux bibliothécaires, au grand public, à des publics plus pointus (étudiants...) ?
- principaux outils d'information et de découverte spécifiques aux revues : quelques bases de données en ligne (notamment le site Ent'revues, qui référence sans discriminer quelque deux mille trois cents titres de revues francophones), le Salon de la revue (national) et quelques manifestations mettant l'accent sur les revues ou l'édition indépendante (Marché de la poésie, Crest, Forcalquier, Limoges...). D'autres ressources bibliographiques existent mais plus éparses : sites thématiques présentant des annuaires ou des sélections (poésie, création littéraire, champs divers des sciences humaines)...
3. Pistes et propositions
- analyser et peut-être s'inspirer du modèle qui a permis le développement du secteur jeunesse en bibliothèque : la constitution de comités de lecture, le développement d'outils de référencement et surtout de critique, la création de résidences d'auteurs
- ce qui marche déjà bien et qui serait à systématiser : des rencontres littéraires (ou autres animations) prenant les revues pour objet/sujet/partenaire. Animées par des personnes dont il s'agit peu souvent de l'activité principale, les revues doivent être encouragées à occuper les terrains (lycées, salons, tous lieux de parole), et à prendre contact au moins avec les bibliothèques-médiathèques dans leurs proximités.
- projet à l'étude au CNL : assortir chaque aide allouée à une revue d'un nombre d'abonnements offerts à des bibliothèques ; cela pose immédiatement la question de la réception de ce titre par les bibliothèques : est-ce imposé, est-ce sur la base de volonté de l'accueillir dans son établissement, de sa spécialisation ? (attention cependant au cloisonnement = ne pas réserver à une seule bibliothèque l'abonnement à tel titre sous prétexte qu'il relève de sa spécialité)
- d'autre part, une bibliothèque qui, de sa propre intiative, développe une collection significative de revues, ne pourrait-elle bénéficier d'un soutien financier de la Région ou du CNL, lui garantissant une stabilité dans les abonnements de titres mêmes confidentiels, voire le développement d'un pôle de revues plus ambitieux ?
- pour adapter le principe du choix validé seulement en fonction de la rentabilité (un principe, donc, qui élimine souvent les revues) : on pourrait rapporter le ratio de « sortie » d'une revue au nombre de bibliothèques abonnées à cette revue, dans telle ou telle communauté (régionale, départementale, urbaine...). Ainsi, une revue « sortant » peu mais présente uniquement dans une ou deux bibliothèques devrait être plutôt soutenue que remplacée par un énième abonnement à un périodique (voire une revue) largement représenté dans d'autres établissements.
- repérer toutes les instances/ressources/outils divers et épars (associations de bibliothèques, centres de formation, catalogues, etc.) ;
- mise en place d'une formation qui inscrive la revue comme objet spécifique et légitime dans l'apprentissage du métier et dans la formation continue (des formateurs devront s'agréger aux suites de ces réflexions)
- aboutir au moins à la mise en commun d'un catalogue descriptif des revues présentes dans les bibliothèques (de la région, du département, de la communauté urbaine...) ; idéalement, ce catalogue pourrait également servi de base à une liste mettant en partage les souhaits d'acquisition et d'abonnements de chacune de bibliothèques.
Le 17e Salon de la revue (19-21 octobre 2007, Paris) sera l'occasion d'approfondir et d'examiner sous quelles formes pourraient être mises en œuvre les pistes soulevées par cette première rencontre.
Copyright © 2002-2008 Ent'revues | Tous droits réservés | Avec le soutien du CNL | | |
